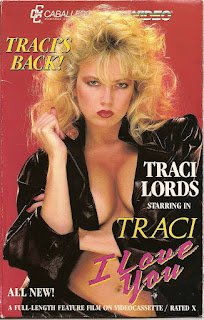Avec la X Trilogy, le réalisateur Ti West et sa muse Mia Goth auront
exploré, ausculté et analysé l’Histoire du cinéma sous divers
angles, de son évolution à son impact dans l’inconscient
collectif. La démarche est d’autant plus captivante que ce qui
aurait pu n’être qu’un lourd pensum se révèle une
déclaration d’amour enragée (ou un cri de colère passionné)
à une industrie qui n’aura eu de cesse de sanctifier ses talents
pour mieux les démolir.
Comment X, Pearl et
MaXXXine éclairent-ils notre rapport au star-system, et rendent-ils
justice aux artistes exploités ? Éléments de réponse.
ATTENTION : CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS
X (2022)
Aussi réussi soit-il, nul doute que X serait resté un coup
d’éclat isolé sans l’implication de Mia Goth, qui joue à la
fois l’anti-héroïne Maxine Minx et l’antagoniste Pearl Douglas.
Le passif de cette dernière se résumait alors à un court synopsis
que le réalisateur offrit à son actrice pour l’aider à cerner le
personnage mais, si préquelle et suite naîtront certes de
l’affection de Goth pour ces rôles, lui en
confier l’incarnation témoignait néanmoins d’une volonté
d’assimiler et non de confronter starlette ratée et aspirante
vedette.
Bluffant travail des maquilleurs sur Pearl
Le postulat de pornstars opposées à des rednecks, propre à raviver
l’esthétique du ciné d’exploitation des 70’s, vaudra au film
d’être vendu comme un simple slasher à l’ambiance surannée qui
ne diffère guère des précédents travaux de Ti West, réalisateur aussi loué que décrié pour sa passion et
son érudition du 7ème Art en général et de sa face underground en particulier, retranscrites avec un soin
méticuleux qui marque tout autant sa force que sa faiblesse. Dans le
meilleur des cas, l’homme nous gratifiait de The Innkeepers,
étonnant film de bâtisse hantée qui invoquait les contes
gothiques de la Hammer pour raviver les spectres d’Amityville ou de
Shining au travers d’une structure héritée de la comédie
indépendante Clerks, la mise en place bavarde et à priori légère
peu à peu effritée par une sombre réalité. Dans le pire des cas,
il se rendait coupable d’un House of the Devil dont l’hommage à
tout un pan du cinéma sataniste des 70’s ne surpassait jamais le
cadre du décalque aussi appliqué que vain. Seule exception dans
cette filmographie ultra-référentielle : The Sacrament,
radicale plongée dans les derniers instants d’une secte
ouvertement inspirée du Temple du Peuple de Jim Jones. L’un des
très rares found footage à justifier son format, approche quasi documentaire qui restera hélas sans
conséquences dans la carrière de Ti West… Du moins jusqu’à X.
Si le goût de West pour la belle image transparaît toujours dans X,
les plans qui invoquent directement Massacre à la Tronçonneuse ou
Le Crocodile de la Mort de Tobe Hooper tiennent moins de la référence
vaine que d’une volonté de prolonger leur approche naturaliste :
les clichés ne persisteront jamais que dans l’imaginaire de
personnages tous dévoués à ce que la caméra peut faire d’eux, leur
libération sexuelle prétexte à poursuivre la démarche
consumériste d’un Debbie Does Dallas cité comme
modèle. Blonde idiote, fausse ingénue, black de service et intello
binoclard se glissent avec joie dans les costumes que l’industrie
du divertissement et par extension les spectateurs attendent de les
voir enfiler, West prenant alors un malin plaisir à disséminer des
moments d’inquiétante étrangeté qui déconstruisent ou
approfondissent les lieux communs afin d’interroger le spectateur
non seulement sur son rapport à l’image, mais surtout aux autres.
Debbie Does Dallas, classique de l'âge d'or du porno et réservoir à clichés qui inspire l'équipe de tournage...
... alors même qu'ils évoluent dans la poisse d'un
Massacre à la Tronçonneuse
(le film de Hooper en haut, l'hommage de West en bas)
West se garde néanmoins de tout jugement moral sur la pornographie,
simplement considérée comme l’aboutissement logique de diverses
influences médiatiques : le réalisateur RJ Nichols (Owen
Campbell) se revendiquera ainsi de la Nouvelle Vague alors que sa
star Maxine Minx vise la série TV Wonder Woman, le
producteur Wayne Gilroy (Martin Henderson) pour sa part ébloui
par l’essor de la VHS. Le vieil Hollywood classieux, le cinéma aux
stars immaculées que l’on n’envisageait que sur grand écran,
n’est plus ici qu’une farce fanée à laquelle même l’ancienne
génération ne croit plus : Pearl Douglas, propriétaire du
ranch qui accueille le tournage et danseuse usée par une vie bercée
d’illusions, explosera moins par pudibonderie que par frustration
de ne pouvoir intégrer cette joyeuse bande. Ses tentatives de se
rapprocher de Maxine, toujours plus bizarres et malsaines, esquissent
un jeu de miroir d’autant plus pervers que la vieille n’est désormais que
le fantôme de valeurs que la jeune s’acharne vainement à fuir :
la TV qui tourne en boucle dans le salon des Douglas, la lucarne que
Maxine aspire tant à hanter, est monopolisée par un prédicateur
qui n’est autre que son père éploré, toujours prompt à encenser les gens pieux et à fustiger
l'entourage de sa fille alors même que les premiers viennent de dézinguer les seconds. Une façon pour West d'entremêler, d'inverser et donc de questionner les motivations des
personnages, et plus encore leur fondement.
Dans l'écran : des promesses de rédemption, de pardon, de salut.
Devant l'écran : un bain de sang.
Il faut ainsi considérer l’explosion de violence du dernier
acte moins comme une inconciliabilité entre générations que comme un sanglant passage de flambeau entre rêves de gloire à jamais insatisfaits, la vocation ratée de Pearl pavant la voie au destin incertain de Maxine. Une simple quoique
fulgurante mise en bouche, les deux figures désormais prêtes à alimenter le propos de West & Goth de riches moments de cinéma.
Pearl (2022)
De l’aveu même de West, Pearl n’aurait guère dépassé le stade
de l’ébauche sans l’implication de Mia Goth. West entreprend
alors d’économiser le budget de X pour tourner la préquelle dans
la foulée, à l’aide de techniciens d’un Avatar 2 lui aussi
filmé en Nouvelle-Zélande mais à l’époque stoppé par le COVID
19. Un contexte particulier, que le réalisateur inclura de façon détournée
dans Pearl.
De l'art d'avancer masqué
Le film prend ainsi place en 1918, dans une campagne ravagée par une
pandémie de grippe espagnole alors que nombre d’hommes sont
mobilisés sur la Première Guerre Mondiale. Un contexte dépouillé
et même désespéré, qui permet à West d’optimiser son faible
budget mais surtout d’ausculter les fondements de ce que Pacôme
Thiellement a souvent (et très justement) qualifié de seule
véritable religion du XXème siècle : Hollywood.
À défaut de nous
gratifier de discours exalté sur le pouvoir des images (coucou
Damien Chazelle) ou de monologue moralisateur sur la balance
politique de l’industrie (hello Jordan Peele), West ne passe jamais
que par l’image pour mieux travailler l’imaginaire collectif.
Ainsi son amour du travail bien fait ravive-t-il les grandes fresques
du Technicolor et les classiques Disney, Pearl telle une Cendrillon
de la cambrousse qui danse et chante devant les animaux de son
étable, avec lesquels elle tient même de longues conversations.
Pas mal, non ? C'est une cinglée
(pardon)
Le spectateur qui a vu X s’attend donc à ce que la rêverie se
heurte tôt ou tard à la dure réalité… Et c’est ici que le
piège se referme, puisque le film nous entraîne dans le délire de
Pearl au lieu de le démolir : face à des scènes de famille
étouffantes, sombres et crasseuses dominées par une mère autoritaire pour ne pas dire psychorigide, il est en effet difficile pour
le spectateur de ne pas s’attacher à la jeune fille alors même
qu’elle reste le fruit de son environnement. Peu importe qu'elle n'esquisse la Dorothy du Magicien d’Oz que pour s’envoyer en l’air
avec l’Épouvantail, ou même qu’elle massacre une oie pour
contenter son alligator : le public a besoin d’une princesse
car on lui a toujours inculqué de croire aux princesses, aux filles
de rien qui s’élèvent par-dessus la masse d’un simple coup de
baguette magique. Et pourquoi Pearl resterait-elle parquée dans sa
grange alors qu’un prince charmant squatte le cinéma local,
projectionniste et donc magicien du fabuleux palais où de simples
danseuses partagent l’affiche avec Theda Bara ?
Theda Bara dans son rôle le plus légendaire.
Pearl en est si fan qu'elle a même nommé son alligator Theda !
La référence demeurera sans doute nébuleuse pour nombre de
spectateurs, elle n’en reste pas moins capitale : grande star
du cinéma muet, Theda Bara est l’archétype de la starlette
façonnée puis jetée par l’industrie. Son rôle de femme fatale
dans Embrasse-moi Idiot lui vaudra le surnom de vamp, terme
aujourd’hui passé dans le langage courant et sur lequel la Fox
capitalisa au travers de rôles toujours plus sexy et/ou
controversés. Le Cléopâtre de 1917 la
couronnera sex-symbol hollywoodien originel, prison dorée dont elle
ressortira essorée après avoir enchaîné pas moins de quarante
(!!!) films en six ans. Celle qui n’aspirait alors qu’à
démontrer une autre facette de son talent sera lâchée par
l’industrie et sombrera dans l’oubli, remplacée par d’autres
starlettes en une chaîne qui engloutira entre autres Judy Garland
(la fameuse Dorothy du Magicien d’Oz), Liz Taylor, Lana Turner,
Hedy Lamarr, Rita Hayworth, Ava Gardner et bien évidemment Marilyn
Monroe ; noms dont le talent certes incontestable n’en demeure
pas moins secondaire pour une industrie qui n'y voit que poupées de chair bonnes à écouler toujours plus de billets. Un
sort somme toute peu enviable, la salle de cinéma ainsi réduite en impasse où le beau projectionniste est moins intéressé par les
pensées de Pearl que par ce qu’elle dissimule sous sa robe, au point de lui révéler le stag A Free Ride alors qu’elle demandait à revoir
la revue de cabaret Palace Follies.
Considéré comme l'un des premiers (si ce n'est le premier) porno,
A Free Ride a légué à ses descendants un goût pour les pseudonymes grivois
L’impasse du star-system est tout entier signifié dans cette
scène, dans une salle de cinéma vide où ne subsiste qu’une Pearl
à la fois fascinée et dégoûtée.
Une ambivalence que West dépeint sans jugement, et même avec une
certaine tendresse lors d’une audition où Pearl visualise sa
chorégraphie dans un non-sens de tranchées, bombardements, feux
d’artifices et french-cancan. L’absolu désœuvrement du
personnage explose dans chaque recoin de l’image, en un spectacle
néanmoins si ébouriffant qu’il est impossible de ne pas en
ressortir enchanté : en moins de deux minutes montre en main, sans la
moindre parole, sans avoir à surligner son propos, West
renvoie le spectateur à son propre conditionnement et à sa propre
ambivalence.
Avouez que c'est mieux que la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
Connaître X, être conscient du destin de Pearl, renforce la dureté
du dernier acte : le refus du jury, et le fabuleux monologue tenu dix
minutes face caméra par une Mia Goth habitée avant l'ultime et ultra-violente décompensation psychotique. Le personnage est
condamné, le renouveau du cinéma d’exploitation ne sera qu’une
chimère de plus, la pornographie est l’ultime aboutissement de
l’industrie et les starlettes ratées ou non doivent accepter leur sort sans broncher.
Et sinon vous, ça va ?
Ingrat, Ti West ?
Comme le dit
l’adage, “qui aime bien châtie bien”… Et les coups
qu’infligera MaXXXine n'en seront que plus aiguisés pour toucher en plein cœur.
MaXXXine (2024)
Une trilogie qui ne parle que d’influence cinématographique devait
en toute logique s’achever dans la Mecque hollywoodienne, et plus
encore dans la ville qui l’abrite : Los Angeles, la Cité des
Anges (déchus) que West scrute avec un naturalisme habilement
enrichi de codes visuels gravés dans l’imaginaire collectif. L’on
aurait pu croire que, dans la lignée de X dont il est la suite
directe, MaXXXine reprendrait à bon compte tous les éléments du
slasher tant le genre dominait la production horrifique des 80’s.
Mais cela aurait été trop facile, évident, et surtout hors-sujet :
plus que jamais, West cherche moins à payer un tribut à quelque
genre ou sous-genre qu’à ausculter leurs racines et héritages ;
et ainsi slasher et porno en sont-ils réduits à des produits de
consommation courante, dupliqués sur toutes les étagères de tous
les vidéo-clubs tant leurs visées mercantiles s’interpénètrent. Il suffira donc à Maxine d’exhiber sa poitrine
lors d’un casting pour passer de l’un à l’autre genre, et West
n’invoquera les fantômes du giallo que pour raviver ceux du film
noir.
L'acte de naissance du giallo
Un parti-pris d’autant plus pertinent que giallo et film noir sont
des genres voisins, qui découlent des romans pulps qualifiés chez
nous de série noire. En Italie, le giallo englobe aussi bien les
polars que ce que les étrangers nomment donc un peu abusivement giallo, terme à la
fois hérité de la typique tonalité jaunâtre des couvertures de
romans de gare que du caractère scabreux voire obscène des pires
faits divers. Le giallo cinématographique a grandement été défini
en 1964 par Mario Bava avec Six Femmes Pour l’Assassin :
contrastes outranciers de couleurs criardes et de sonorités tour à tour agressives et obsédantes, crimes toujours plus
sadiques et élaborés, plans subjectifs, et surtout mise à mal de la notion même de
féminité par un tueur à l’arme blanche tout de noir vêtu.
La figure qui hante le genre, et que West lance aux trousses de Maxine
Des bases fortes, qui seront allégrement reprises par le slasher :
dans son matriciel Halloween, John Carpenter présente son mythique
Michael Myers en vue subjective sur un thème musical aussi
élémentaire qu’identifiable pour mieux le coller aux basques de
baby-sitters délurées. Mais si Big John a bien sûr l’intelligence
d’enrichir et de réinterpréter ses influences plutôt que de les
copier bêtement, nombre de suiveurs se contenteront d'encaisser les recettes offertes par seins à l’air et gore de
pacotille. Le giallo et les premiers slashers, qui mine de rien
décortiquaient les rapports de genre voire de classes d'après des postulats de faits divers somme toute crédibles, n’engendrent au mitan des 80’s que pléthore de produits dévitalisés plus honteux que le pire Vendredi 13.
Un bel aperçu du niveau d'alors avec ses titres, pitchs et tueurs interchangeables
L'on comprendra donc que West se contrefiche de pareil
foutoir, ses rares envolées giallesques telles les réminiscences
d’un monde lointain, d’aspirations artistiques perdues et
réduites à leur portion congrue.
Son hommage au
Psychose de Hitchcock, sans nul doute l’autre mamelle nourricière
du slasher, est lui aussi empreint d’une tendresse désabusée :
s’il filme le célèbre Bates Motel avec précision, l’illusion
vole en éclats dès que Maxine entreprend de s’y planquer. Le
décor n’est plus que cela : une façade sans issue, sans
matière, aussi désincarnée que la factice ville de far west où
une confrontation à priori parodique avec un stalker se conclut dans
la violence des vraies rues de Los Angeles. Ainsi West débarrasse-t-il le
film noir de tous ses oripeaux, de toutes les surcouches imposées
par l’industrie, pour le ramener à sa nature d’élément
perturbateur, de frondeur qui gratte le vernis pour révéler la
crasse. Le cinéma entretient Los Angeles, il n’est cependant
d’aucun recours à Los Angeles.
L'héritage des maîtres réduit en parc d'attraction
Pire encore : il pourrait même causer sa perte.
Après tout, aussi
nécessaire soit-il, le film noir n’était déjà qu’une
déclinaison du beaucoup plus subversif roman noir. L.A. a toujours
su tirer parti de ses propres tares, processus qui en 1985 passe par
une arme d’un nouveau genre : la caméra vidéo. Poursuivie
tout au long de sa mésaventure par un détective qui n’est pas
sans rappeler l’Homme à la Caméra du Lost Highway de David Lynch (autre déconstruction majeure du rêve hollywoodien s'il en est), Maxine sera in
fine confrontée à une secte régie par son prédicateur de père, qui sait qu'immortaliser le calvaire de sa fille ne pourra qu'étendre son empire.
Ce que nous annonce
West n’est ni plus ni moins que la disparition du cinéma au profit
d’une industrie plus obscène encore que la pornographie : la
TV réalité. Plus obscène car elle pousse le voyeurisme à son
paroxysme, plus obscène car
le talent n'est plus qu'une donnée superfétatoire lorsque tout quidam devient la star de son propre système, plus obscène car elle
pave ainsi la voie à la spectaculaire intrusivité des réseaux sociaux,
plus obscène car elle tire ouvertement profit du malheur d’autrui.
À ce titre, impossible de ne pas se remémorer le tristement célèbre
Dahlia Noir au travers des cadavres que la secte dissémine en
ville : de par son vernis de respectabilité et même de
moralité, de par ses sombres et insatiables appétits, le père de
Maxine est l’incarnation presque surnaturelle d’un système qui a
perverti ou démoli près d’un siècle de starlettes, le maître des illusions et désillusions.
Freud avait pourtant bien dit qu'il fallait tuer le père...
Et Maxine, là-dedans ? Les ombres de Theda Bara, d’Elizabeth
Short et bien sûr de Pearl Douglas transparaissent d’autant mieux
dans sa figure vengeresse qu’elle tient moins de son père que d’un
système appelé à disparaître : Maxine Minx, ce n’est ni plus ni
moins que Marilyn Monroe qui se serait réincarnée en Traci Lords.
À gauche : Norma Jeane Baker dite Marilyn Monroe, l'orpheline qui passa sa vie à chercher un père dans le pire endroit possible.
À droite : Nora Louise Kuzma dite Traci Lords, celle qui a fui le sien pour tout faire sauter.
Traci Lords céda aux sirènes du X alors qu’elle était encore mineure, sous une
fausse identité que personne ne prenait vraiment la peine de
contrôler tant la demoiselle rapportait. Tel un agent dormant, la gamine abusée par tous les hommes de son
patelin paumé enchaîna les films et les profits pour mieux passer à l'action : alors plus grande star du X, elle fonde sa propre
compagnie de production et tourne un dernier film peu après son
dix-huitième anniversaire. Traci I Love You est ainsi la seule vidéo à
pouvoir être commercialisée en toute légalité lorsque le pot aux
roses est révélé, par un appel anonyme que nombre de biographes
attribuent à Lords elle-même. Pour reprendre le contrôle de son
image, de sa vie, Traci Lords s’est payée l’industrie.
Nombre de producteurs et d'agents tombèrent suite aux enquêtes ouvertes par ce coup de poker
La revanche de Maxine, moins subtile mais toute aussi cathartique,
est la synthèse parfaite de l’ambivalente démarche de West sur
cette trilogie. Un auteur à la fois forgé par le 7ème Art et
conscient de ses limites, tout autant biberonné par Hollywood que
par le cinéma d’artistes indépendants, qui évolue aux abords
d’une industrie dont il se méfie, capable d'offrir à Marilyn un baroud d’honneur contrasté entre la lumière du Once Upon a Time in Hollywood de
Tarantino et la noirceur du Mulholland Drive de David Lynch.
Une Maxine Minx éthérée, aux atours de blonde légendaire.
Marilyn reste bien sûr où elle est et Hollywood s'en relèvera comme le X s'est relevé de la bombe Traci Lords, mais remettre les pendules à l'heure en honorant les vrais artistes ne fait jamais de mal.
La X Trilogy est une œuvre dont le nihilisme n’a d’égal que la
passion, animée de la conviction qu’un système par essence
déglingué et mortifère peut néanmoins accoucher de réflexions
pertinentes voire lumineuses si de véritables artistes s’emparent
de ses armes.
Hollywood est mort,
vive le cinéma.




















_still_2.png)