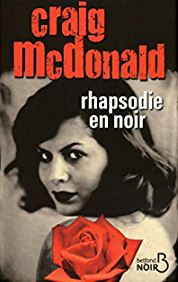Pour inaugurer cette série de trois articles traitant de la pensée individualiste au travers d'œuvres cultes, la logique exige de commencer par celui qui est considéré comme le père de l'anarchisme individualiste, à savoir Max Stirner.
Philosophe allemand né en 1806 et mort en 1856, son œuvre repose principalement sur L'Unique et sa Propriété, pavé dans lequel il développe sa vision de l'Humain au gré d'une attaque féroce de tous les dogmes envisageables. Peu importe qu'ils ne reposent sur des idéaux moraux, idéologiques ou religieux, puisque Stirner n'accorde pas plus de légitimité à l'un qu'à l'autre à partir du moment où leur mise en application paralyse ce qu'il appelle son "Moi". Selon lui, l'individualisme est synonyme de salut et de véritable progrès, là où toute forme de communautarisme ne peut que brider le potentiel humain.
Philosophe allemand né en 1806 et mort en 1856, son œuvre repose principalement sur L'Unique et sa Propriété, pavé dans lequel il développe sa vision de l'Humain au gré d'une attaque féroce de tous les dogmes envisageables. Peu importe qu'ils ne reposent sur des idéaux moraux, idéologiques ou religieux, puisque Stirner n'accorde pas plus de légitimité à l'un qu'à l'autre à partir du moment où leur mise en application paralyse ce qu'il appelle son "Moi". Selon lui, l'individualisme est synonyme de salut et de véritable progrès, là où toute forme de communautarisme ne peut que brider le potentiel humain.
"L'individualité est l'universelle créatrice , et depuis longtemps déjà : on regarde une de ses formes, le génie (qui toujours est singularité ou originalité), comme le créateur de toutes les œuvres qui marquent dans l'histoire du monde."
(note : toutes les citations en gras de cet article sont issues de L'Unique et sa Propriété)
L'un des multiples crayonnés représentant Max Stirner.
À noter qu'il n'existe à priori aucune photo de l'homme.
Qualifier l'ouvrage de brûlot serait un doux euphémisme, et Stirner lui-même en avait d'ailleurs conscience puisqu'il le publia sous forme de vingt cahiers de seize pages chacun, distribués plus ou moins sous le manteau. Si le procédé visait à échapper à la censure, celle-ci ne tardera guère à mettre la main sur un ouvrage dont la dangerosité saute aux yeux, tant Stirner y dézingue sans préavis et sans complexe tous les fondements civilisationnels en place depuis des millénaires, quand il ne ridiculise pas des idéologies alors en vogue.
Ainsi donc, les premières pages taxent Jésus de sale impie qui profana l'héritage de ses pères pour sa propre gloriole (ça commence fort) ; tandis que les dernières fustigent le communisme et sa prétendue libération des travailleurs, qui ne passe cependant que par une persistance du travail pour tous. Stirner y voit la preuve que la fameuse "valeur travail" est devenue la nouvelle sacro-sainte règle, seulement destinée à se substituer à une notion du Sacré plus littérale mais tout aussi oppressive. En somme : la faucille et le marteau ont remplacé le crucifix.
Entre ces deux extrêmes, Stirner réévalue l'Histoire de l'Humanité en tendant à prouver que ce déplacement du Sacré fut constant, dirigé vers des institutions étatiques, spirituelles ou encore morales ; qui toutes n'avaient pour but que de contenir la salvatrice fougue créatrice et libératrice du Moi au travers de règles strictes.
"Aucune pensée n'est sacrée, car nulle pensée ne doit être une dévotion ; aucun sentiment n'est sacré (il n'y a point de sentiment sacré de l'amitié, de saint amour maternel, etc.), aucune foi n'est sacrée. Pensées, sentiments, croyances sont révocables et sont ma propriété, propriété précaire que Moi-même je détruis comme c'est Moi qui la crée."
L'ouvrage en question, depuis tombé dans le domaine public.
L'édition ci-dessus est d'ailleurs disponible gratuitement sur Amazon.
Pareille démolition de toutes notions tenues pour acquises ne pouvait évidemment recevoir qu'un flot de réactions diverses et variées, qui allèrent de la célébration à la répugnance. À ce sujet, le plus grand détracteur de Max Stirner restera sans nul doute Karl Marx, qui goûtait fort peu à l'analyse stirnerienne du communisme. Marx pétera même un tel boulon qu'il accouchera d'un pamphlet qui reprend quasiment chaque affirmation de L'Unique et sa Propriété, agrémenté d'attaques parfois ad hominem contre celui qu'il considérait comme un dangereux ennemi à abattre. Chacun jugera de la légitimité, de l'intérêt ou même de la maturité de pareille démarche... D'autant plus qu'en agissant de la sorte, Marx confortait de facto une partie du propos de Stirner.
"L’homme fait diffère du jeune homme en ce qu'il prend le monde comme il est, sans y voir partout du mal à corriger, des torts à redresser, et sans prétendre le modeler sur son idéal. En lui se fortifie l'opinion qu'on doit agir envers le monde suivant son intérêt, et non suivant un idéal."
Qui plus est, les faits seuls parlent en faveur de Stirner : le communisme a depuis (et dans le meilleur des cas) démontré ses limites, tout autant que la machine politique allemande qui censura L'Unique et sa Propriété. Et cela sans même parler du IIIème Reich, qui s'acharnera à garder l'œuvre de Sirner sous scellés.
Mais cela n'a jamais empêché Stirner et ses théories de revenir hanter à intervalles réguliers la philosophie, les arts ou même la culture populaire. Celui qui est considéré par certains essayistes comme un nihiliste auprès duquel Nietzche lui-même est faible et inconséquent influencera certain(e)s penseurs(euses) parmi les plus influent(e)s du XXème siècle (et qui seront les sujets des deux prochains articles) ; tandis que sa vision de l'individu en pleine possession de ses moyens et en guerre contre toute forme d'autorité est devenu l'un des socles de la culture populaire. Il s'agit notamment du cow-boy solitaire des westerns, figure que Clint Eastwood recyclera et sublimera tout au long de sa carrière ; mais l'on pourrait citer d'autres artistes qui célèbrent la puissance du Moi et de son décalage salvateur face aux masses qui ont un peu trop tendance à regarder dans la même direction : le roman noir conceptualisé par Dashiell Hammett et Raymond Chandler en est un bel exemple, et cela d'autant plus que son approche a depuis infusé d'autres genres tout aussi populaires.
Mais s'il ne fallait retenir qu'un artiste aussi libre et par extension fouteur de merde que Stirner, et qui peut donc se réclamer de sa pensée plus que quiconque, il s'agirait sans nul doute de John Carpenter.
L'homme, le mythe, la légende
Fort d'une filmographie aussi frondeuse que maîtrisée, celui que l'on surnomme Big John aura passé sa carrière à flinguer un statu quo aussi bancal que contestable, que ce soit au travers d'une approche particulière de ses sujets ou par la glorification d'antihéros si évocateurs qu'ils sont désormais inscrits dans l'imaginaire collectif. Et puisque l'influence de Stirner sur le plus célèbre d'entre eux a déjà été abondamment étudiée, je ne peux décemment pas faire l'impasse sur le sublime salopard en question, qui demeure la plus parfaite introduction à une analyse individualiste de l'œuvre de Carpenter.
"CALL ME SNAKE"
Le dytique Snake Plissken
"Mieux vaut un enfant indiscipliné qu'un enfant modèle, mieux vaut l'homme qui se refuse à tout et à tous que celui qui consent toujours : le récalcitrant, le rebelle peuvent encore se façonner à leur gré, tandis que le bien stylé, le bénévole, jetés dans le moule général de l'espèce sont par elle déterminés : elle leur est une loi."
Snake Plissken (Kurt Russell), l'antihéros du dytique New York 1997 / Los Angeles 2013, n'obéit qu'à son propre instinct de préservation et n'éprouve donc aucun respect pour un gouvernement qui le contraint à une mission-suicide. Cette réaction, aussi logique soit-elle, semble pourtant désarçonner ses supérieurs d'un soir : ainsi, ce sont tour à tour Lee Van Cleef (dans New York 1997) et Stacy Keach (dans la suite) qui lui cracheront avec mépris qu'il n'a visiblement "rien à foutre de rien", ce que Snake assume avec une décontraction qui a valeur de doigt d'honneur. Il n'a cependant guère plus d'empathie pour les habitants de l'île-prison où on l'envoie, et cela d'autant plus qu'ils sont nombreux à tenter de le neutraliser, et donc de faire obstruction à son Moi.
Trop indiscipliné pour l'État US qui prétend le tenir en laisse, trop intègre pour les prisonniers qui le considèrent comme une menace, Snake Plissken ne peut tout simplement pas trouver sa place entre deux camps qui cherchent, chacun à leurs manières, à s'approprier sa force : tandis que les instances militaires aspirent à en faire une arme, les prisonniers l'entrevoient comme un trophée on ne peut plus symbolique à arborer lors de leur plan d'évasion. Deux façons différentes de mater l'individu, mais pour le réduire in fine à un simple outil.
Snake devient alors un véritable miroir déformant des ambitions à priori éloignées des deux parties en présence : incapables d'appréhender cet être en pleine possession de ses moyens, les deux camps se confondent peu à peu au travers de ceux qui sont pourtant sensés les dominer, réduits en figures pathétiques et interchangeables. On soulignera d'ailleurs l'intelligence de Carpenter sur New York 1997, qui fait passer par l'image les similarités tout autant que les différences entre les deux leaders adverses : nous sommes ainsi face à deux chauves légèrement ventripotents et affligés de tics faciaux, l'un blanc (Donald Pleasence en président US) et l'autre noir (Isaac Hayes en autoproclamé Duke de New York), le premier vêtu d'un costume très élégant mais de plus en plus déchiré au fil du récit tandis que le second arbore des fripes toujours plus clinquantes. L'inversion et même l'assimilation d'une figure par l'autre va crescendo tout au long du film, et atteint son apogée lorsque le Duke toujours prêt à arborer sa virilité est finalement abattu comme une merde par un président jusqu'alors fort mollasson.
Une certaine similitude physique, et plus encore morale
Il faut enfin souligner cette pirouette finale, lorsque Snake remplace le discours pré-enregistré du président par une chansonnette entêtante qui lui donnerait presque des allures de popstar prise en flagrant délit de play-back... Faut-il préciser qu'Isaac Hayes, interprète du personnage que Pleasence vient donc d'abattre, était lui-même une popstar ? Un procédé roublard et quasiment méta de la part de Carpenter, tout autant que le sourire en coin qu'arbore Snake lors de l'ultime plan du film.
"C'est contre l'individu, et non contre l'État, que se brisent tous les partis."
- Max Stirner
Si New York 1997 ne présentait guère plus que les extrapolations d'un état policier opposé à des criminels vaguement politisés, Los Angeles 2013 se montre carrément visionnaire : avec près de vingt ans d'avance, le film pressent notre ère hypra-connectée, prompte à mettre en scène n'importe quelle indignation immédiatement transformée en engagement idéologique. L'Amérique est donc désormais un pays ouvertement fasciste où la célébration surmédiatisée de la foi et de la morale supplante celle du simple capital ; tandis que les prisonniers de Los Angeles sont pour la plupart menés par Cuervo Jones (Georges Corraface), un ersatz de Che Guevara prêchant une révolution de pacotille, dûment mise en scène, et qui n'est qu'un simple prétexte à prendre le pouvoir. Difficile de ne pas y discerner la caricature de quelques dérives fort actuelles, tant certains brandissent aujourd'hui leur morale comme une arme ultime, chacun taxant son opposant des mêmes qualificatifs au cœur d'une cacophonie hystérique où celui qui hurle le plus fort gagne le droit d'imposer son ressenti. En somme et comme le souligne Snake : "vous gagnez, ils perdent ; vous perdez, ils gagnent... Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes".
Ci-dessus : le président américain et Cuervo Jones, deux idéologies différentes, la même fierté mal placée
"Essayez donc d'entreprendre un tel fou au sujet de sa manie, immédiatement vous aurez à protéger votre échine contre sa méchanceté; car ces fous de grande envergure ont encore cette ressemblance avec les pauvres gens dûment déclarés fous qu'ils se ruent haineusement sur quiconque touche à leur marotte. Ils vous volent d'abord votre arme, ils vous volent la liberté de la parole, puis ils se jettent sur vous les griffes en avant. Chaque jour montre mieux la lâcheté et la rage de ces maniaques, et le peuple, comme un imbécile, leur prodigue ses applaudissements."
Los Angeles 2013 illustre à merveille cette citation de Stirner, tant le film s'acharne à dépeindre deux communautés plus impitoyables encore que celles du film précédent. Dans New York 1997, Snake pouvait compter sur l'aide toute relative d'Harold (Harry Dean Stanton), mais ce sont surtout Taxi (Ernest Borgnine) et Maggie (Adrienne Barbeau) qui incarnaient d'indéfectibles soutiens. De même, en dépit d'une opposition radicale, le personnage de Lee Van Cleef parvenait de-ci de-là à lier une certaine connivence avec Snake, au détour de quelques échanges étonnamment complices et même empreints de respect. Rien de tout cela dans Los Angeles 2013 : le personnage de Stacy Keach, qui fait donc écho à celui de Van Cleef, est un véritable illuminé qui passe tout le film à traiter Snake comme de la merde, à l'instar de tous les alliés approximatifs que l'antihéros croise lors de sa mission. Le plus pathétique représentant en est sans nul doute Eddie (Steve Buscemi), aspirant impresario paré à tous les coups de pute, et qui ne considère Snake que comme une monnaie d'échange en vue de grimper les échelons dans la hiérarchie de Cuervo Jones.
Seules lueurs d'espoir dans ces ténèbres : les apparitions très fugaces de Taslima (Valeria Golino) et Pipeline (Peter Fonda), deux âmes tout aussi libres que Plissken. Pipeline s'avère même être le seul personnage du dytique pour lequel Snake démontrera un brin d'enthousiasme (au détour d'une tape amicale, autrement dit un geste lourd de sens pour un socioptahe tel que lui), tandis que Taslima prend subrepticement les atours d'un love-interest qui ne le laisse guère indifférent. Son sort sera malheureusement funeste, soumis à l'agressivité d'un monde où Snake erre tel un fantôme, réminiscent symbole d'une liberté passée qu'il convient d'anéantir.
Au royaume des aveugles, le borgne est roi
"C'est la marque de toutes les tendances réactionnaires de vouloir instaurer quelque chose de général, d'abstrait, un concept creux et sans vie, tandis que les vœux des égoïstes tendent à délivrer les individus pleins de vie et de vigueur du faix des généralités abstraites."
Proposition que Snake signifiera mieux qu'aucun autre antihéros du 7ème Art lors d'un final gonflé, véritable doigt d'honneur brandit à la face d'à peu près tout et tout le monde, durant lequel il retourne les armes de ses oppresseurs pour littéralement éteindre la Terre (et pour le plus grand bonheur d'un personnage nommé Utopia, ça ne s'invente pas). Tous les camps sont renvoyés dos à dos, tous les hystériques sont soudainement contraints au silence et forcés de se remettre en question, et Snake peut enfin savourer sa clope au détour de cette répartie lourde de sens : "bienvenue parmi les humains".
À noter que l'ultime plan du film concorde avec le début de The One de Rob Zombie, dont les paroles sont un véritable hymne à l'individualisme
On pourrait croire que l'influence stirnerienne de Carpenter ne se limite qu'à Snake Plissken tant le personnage est une véritable allégorie de sa pensée, mais ce serait oublier que l'aura du personnage transparaît chez nombre d'antihéros de son cinéma. Parmi eux, deux en particulier attirent l'attention.
JACK CROW, L'HÉRÉTIQUE
"Il ne se regarde pas comme un instrument de l'Idée ou un vaisseau de Dieu, il ne reconnaît aucune vocation, il ne s'imagine pas n'avoir d'autre raison d'être que de contribuer au développement de l'humanité et ne croit pas devoir y apporter son obole ; il vit sa vie sans se soucier que l'humanité en tire perte ou profit."
Si cette citation pourrait très bien s'appliquer à Snake, elle convient d'autant mieux à Jack Crow (James Woods), l'antihéros de Vampires.
En effet, si Jack travaille bien pour le Vatican, difficile de voir en lui un enfant de chœur ou même un croyant : le type ne carbure qu'aux bastons, aux putes et à la gnôle. Carpenter prend d'ailleurs le contre-pied du roman original de John Steakley (dans lequel Jack était un guerrier tout ce qu'il y a de plus dévot), afin de renvoyer une fois encore deux camps dos à dos : ainsi, tandis que clergé et vampires s'acharnent à considérer Jack comme un véritable croisé, celui-ci n'en fait qu'à sa tête au point de se foutre ouvertement de la gueule du curé censé le superviser. L'Église n'est pour Jack qu'un moyen, un biais par lequel il peut accomplir la tâche qui lui tient à cœur, et dont la violence le comble de plaisir. Ouvertement égoïste au point de se mettre à peu près tout le monde à dos, Jack ne fait pourtant que se mettre au diapason tant de ses ennemis que de ses employeurs, qui révéleront d'ailleurs leur connivence lors du twist final.
"Prenons comme exemple ce livre avec lequel des millions d'hommes ont été en rapport depuis bientôt vingt siècles : la Bible. Qu'a-t-elle été pour chacun d'eux ? Ce qu'il en a fait, et rien d'autre. Elle n'est rien pour celui qui n'en fait rien ; pour celui qui en use comme d'une amulette, elle a uniquement la valeur et la signification d'un charme ; pour l'enfant qui joue avec elle, elle est un jouet, etc."
Une considération qui s'applique parfaitement à Jack...
Et le film de poser insidieusement cette question : au travers de son égoïsme, Crow n'use-t-il pas du Livre Saint avec infiniment plus de sagesse, ou du moins de pertinence, que les communautés qui s'en réclament ? Faire d'un hérétique tel que lui une figure salvatrice, voilà bien une inversion des valeurs typique de l'anarchie individualiste !
Loué soit notre Sauveur, et sa tendance à tout faire péter
JOHN NADA, LE SÉDITIEUX
Par bien des aspects, Invasion Los Angeles pourrait passer (et passe d'ailleurs toujours) pour le film le plus gauchiste de son auteur. Mais ce serait faire l'erreur de rester en surface, de considérer les envahisseurs ultra-capitalistes comme les seuls personnages roublards du métrage, et d'omettre plus ou moins sciemment certains détails concernant le camp d'en face... Un peu comme les détracteurs de Stirner, qui oublient souvent que l'homme a lui aussi largement contesté le capitalisme.
"Le capital est ici le fonds, la mise, l'héritage (naissance) ; l'intérêt est la peine prise pour faire valoir (travail) : le capital travaille. Mais pas d'excès, pas d'ultra, pas de radicalisme ! Evidemment, il faut que le nom, la naissance, puissent donner quelque avantage, mais ce ne peut être là qu'un capital, une mise de fonds ; évidemment, il faut du travail, mais que ce travail soit peu ou point personnel, que ce soit le travail du capital — et des travailleurs asservis."
Les extraterrestres du film correspondent en tous points à cette analyse : les dés sont pipés dès le départ, les règles ont été confisqués par ces capitalistes galactiques, et les humains aveuglés et asservis ne sont bon qu'à faire fructifier la mise de départ. De ce point de vue, pas de problème, Invasion Los Angeles est bien le grand film anticapitaliste souvent vanté.
V'là la gueule du Grand Capital
Mais pour autant, le camp d'en face est-il louable ? John Nada (Roddy Piper), la figure centrale du film, l'est assurément. Mais par petites touches, Carpenter montre bien qu'il n'est en vérité que peu affilié à la résistance et qu'il est surtout un électron libre, là où les leaders révolutionnaires démontrent quelque roublardise à peu près égale à celle de leurs opposants.
"Si le Communiste voit en toi un homme et un frère, ce n'est là que sa manière de voir des dimanches ; les autres jours de la semaine il ne te regarde nullement comme un homme tout court, mais comme un travailleur humain ou un homme qui travaille."
Et la petite caste (par ailleurs constituée de figures bourgeoises) qui prétend libérer les opprimés ne déroge pas à ce constat : au cours d'un dialogue, le chef de la bande (Peter Jason) scande d'ailleurs à ses collègues qu'il leur faut recruter des gens prêts à se battre POUR EUX. Ces leaders recherchent donc des bras armés à leur service, et les appâtent avec des repas gratuits prétextes à leur servir en prime quelque discours politiques, histoire de déterminer qui est apte à partir au combat.
Le film se demande alors si la lutte des classes aboutira à autre chose qu'une nouvelle domination formellement différente mais fondamentalement similaire, question à laquelle il esquisse une réponse au détour d'un personnage secondaire : un SDF aigri (George Buck Flower) réapparaît dans le dernier acte en businessman friqué, qui a trahi ses idéaux pour un confort de pacotille. Cinglante image.
Qui a dit que "plus les choses changent et plus elles restent les mêmes" ?
"L'Esprit reste le maître absolu des uns et des autres, et s'ils se querellent, c'est uniquement pour savoir qui s'assiéra sur le trône héréditaire de « lieutenant du Seigneur »."
Ne reste plus alors à John Nada / Carpenter que d'agir à sa guise et de tout faire péter avec un ultime doigt d'honneur que ne renierait pas Snake Plissken, honorant de facto cette percutante maxime de Stirner : "la liberté du peuple n'est pas ma liberté".
Ni dieu ni maître... Mais un bon gros doigt
Cette vision d'un monde où le Moi doit toujours se dresser face à des camps somme toute indistincts souligne une autre constante du cinéma Carpenterien : sa représentation d'un mal insidieux, prompt à dévitaliser les humains de tout ce qui fait leur force.
L'APOCALYPSE SELON ST. JOHN
Dans l'œuvre de Carpenter, trois films séparés de plusieurs années constituent ce qu'il surnomme sa "Trilogie de l'Apocalypse". Plus que tous ses autres films, ceux-ci traduisent avec une évidence fulgurante sa peur panique, son aversion et même sa répugnance envers l'assimilation, l'indifférenciation, et la négation de l'individu. À ce sujet, le film qui ouvre la Trilogie est sans nul doute le plus limpide de son auteur. Je parle évidemment de The Thing.
"NE M'ASSIMILEZ PAAAAAS !!!"
Un résumé succinct du film suffit d'ailleurs à planter son propos : nous sommes face à une association de gens dissemblables mais qui travaillent cependant en bonne intelligence, jusqu'à ce qu'une créature extraterrestre ne vienne foutre la merde en tentant de les assimiler un à un, qui plus est en recopiant leur apparence.
En découle un chef-d'œuvre parano, où chacun scrute son voisin pour déterminer s'il ne s'agit plus que d'une sinistre créature prête à transformer ses cibles en coquilles vides.
La monstruosité des apparences
Il s'agit plus que jamais de se battre pour rester humain, au risque sinon de se muer en monstres toujours plus dégoûtants : pattes d'araignée, tentacules, mâchoires surgies de nulle part... Le corps de ceux qui ont cédé le moindre pouce de terrain n'est plus qu'une arme au service de la conscience à laquelle ils obéissent, illustrant ainsi la pensée de Stirner concernant la guerre constante du Moi face aux oppresseurs de tous bords.
"Vaincre ou être vaincu — pas d'autre alternative. Le vainqueur sera le maître, le vaincu sera l’esclave : l'un jouira de la souveraineté et des « droits du seigneur », l'autre remplira, plein de respect et de crainte, ses « devoirs de sujet »."
Second volet de la Trilogie, Prince des Ténèbres ne fait jamais qu'enfoncer ce constat, tout en le doublant de tirs à balles réelles envers la religion : les possédés y sont au mieux désincarnés, représentés en insectes accomplissant une basse besogne (les SDF menés par Alice Cooper) ; au pire défigurés ou même morts-vivants, simples enveloppes au service d'un esprit supérieur et démoniaque. L'on pourrait dès lors considérer Prince des Ténèbres comme un film catholique si ce marasme n'avait justement pas été causé par les mensonges répétés de l'Église, dont on apprendra qu'elle protège le Diable en son sein depuis toujours.
Welcome to my nightmare
L'église dans laquelle se déroule le film devient dès lors une prison, une enceinte propice à la propagation d'un mal insidieux qui non seulement transforme les faibles en possédés, mais qui martyrise aussi les résistants en les privant de sommeil réparateur. Carpenter semble alors prendre au mot cette déclaration de Stirner : "L'homme n'a vraiment triomphé du chamanisme et de ses fantômes que lorsqu'il a eu la force de rejeter non seulement la croyance aux fantômes et aux esprits, mais aussi celle à l'esprit."
Et Big John d'illustrer ce propos en renvoyant une fois de plus dos à dos deux camps bien distincts : si la dévotion religieuse y est source de maux, la foi aveugle en la science n'est pour autant d'aucune aide, et il faudra comme toujours que quelqu'un outrepasse toutes les croyances afin qu'une terrible menace ne soit neutralisée. Un sacrifice qui fait d'ailleurs écho à celui de MacReady (Kurt Russell) dans The Thing : simple pilote d'hélico dans une base avant tout scientifique, l'homme est présenté dès le départ comme un élément à part de la troupe, dont la force est cependant bien (trop ?) utile à la communauté.
"J'en ai marre de faire tout le boulot, moi..."
Dernier film de la Trilogie, L'Antre de la Folie s'attaque d'ailleurs directement à la question de l'esprit, et d'une manière on ne peut plus évidente puisque le Mal se propage au travers de livres : les mots de Sutter Cane (Jürgen Prochnow), aspirant messie d'un nouveau monde façonné par ses mains maléfiques, imprègnent si cruellement les rétines de ses dévots qu'ils en pleurent du sang. Et c'est encore une fois un homme seul (Sam Neill), un peu plus malin que la moyenne, capable dans un premier temps de plonger dans les écrits de Cane pour les analyser sans perdre la raison, qui s'avère être le pilier d'un monde en pleine déconfiture. Du moins, jusqu'à ce qu'il ne se frotte de trop près à l'écrivain maudit, devenant dès lors l'ultime biais de la contamination démoniaque.
"J'ai vu..." Bah, ça ne donne pas envie d'avoir une révélation !
Le message est on ne peut plus clair : frayer de trop près avec les prophètes, guides spirituels ou leaders en tous genres est la voie de la destruction. "Tout ce qui est sacré est un lien, une chaîne", pour citer Stirner.
V'là la gueule du Sacré
Enfin et même s'il ne fait logiquement pas partie de cette Trilogie, Le Village des Damnés mérite à mon sens d'être mis en lumière tant ses thématiques y font écho.
Tout comme The Thing, il s'agit du remake d'un classique traitant d'invasion extraterrestre (et qui plus est, les deux titres appartiennent à Universal), mais l'angle d'attaque diffère totalement : The Thing met en scène une créature indistincte au processus d'assimilation chaotique, tandis que Le Village des Damnés présente une petite troupe d'aliens aux codes sociaux ultra-conformistes, abrités par des corps d'enfants (ce qui possède une indéniable puissance symbolique), et au schéma de conquête si organisé qu'il en devient presque martial.
Concernant les points communs avec la Trilogie, on pourra une nouvelle fois noter l'inefficacité de l'Église (au travers d'un Mark Hamill en pasteur complètement dépassé), une perversion hérétique des codes religieux (une adolescente y est littéralement victime d'immaculée conception, et accouche d'un fœtus monstrueux), ainsi qu'un modus operandi qui s'attaque une fois de plus à l'esprit de par la télépathie des envahisseurs.
Mais le film devient vraiment intéressant en ce qu'il présente une possibilité de salut non pas chez les asservis, mais chez les oppresseurs : c'est en effet le petit David (Thomas Dekker), extraterrestre esseulé et par défaut solitaire, qui incarne la possibilité d'un refus des codes sociaux au travers de son apprentissage autodidacte de l'humanité. Il est dès lors le seul alien en mesure de survivre, ce qu'atteste le dialogue doux-amer qui clôt le film, et qui n'est pas sans rappeler celui qui concluait The Thing. Mais là où le film culte s'achevait dans la noirceur, le remake mal-aimé nous offre un ultime regard empreint de lumière.
David, le seul extraterrestre qui cherche à regarder ailleurs
Il serait toutefois erroné d'y voir l'accalmie de Carpenter car, aussi douce soit la conclusion, elle ne survient qu'après 90 minutes d'oppression. Il est plus intéressant d'entrevoir cette scène sous le prisme de l'association telle que souhaitée par Stirner, mais magnifiée et même détournée par Carpenter au travers d'un personnage féminin : en effet, là où MacReady se targuait d'un ultime sourire ironique, la mère de David (Linda Kozlowski) adresse ici à l'extraterrestre un regard bienveillant. Il est d'ailleurs important de noter que les femmes sont souvent source d'espoir chez Big John, mais j'y reviendrais.
L'UNION FAIT LA FORCE
Ou, dans le cas de l'individualisme prôné par Stirner, l'association d'individus pleinement formés et néanmoins conscients des limites de leur forces permet, selon un accord tacite mais résiliable à tout instant, de démolir l'oppression.
"Nul n'est pour Moi une personne respectable, pas même mon semblable, mais simplement, comme tout autre être, un objet, pour lequel J'ai de la sympathie ou non, intéressant ou inintéressant, sujet utilisable ou inutilisable. Si je puis l'utiliser, Je Me mets d'accord et M'unis avec lui, afin de renforcer Mon pouvoir par cet accord et de faire plus, grâce à notre force commune, qu'une seule force isolée ne pourrait faire. Dans cette action commune, Je ne vois absolument rien d'autre qu'une multiplication de ma force et Je ne la fais durer qu'aussi longtemps qu'elle est Ma force multipliée. Mais, ainsi, c'est une association."
Dans les grandes lignes, Carpenter respecte cet adage dès son premier film professionnel, à savoir Assaut. Cependant, il y marque également sa différence majeure avec Stirner : pour Big John, selon certaines conditions, l'autre peut être tout aussi semblable et donc respectable que ce fameux Moi.
Néanmoins, la confiance se gagne : non pas au gré de belles paroles et de promesses qui n'engagent que celui qui y croit, mais en prouvant sa valeur dans l'action. Pour Carpenter, un homme ou une femme se définissent uniquement dans leurs actes, qui permettent aux individus respectables de se reconnaître entre eux par-delà les constructions sociales.
Dans Assaut, cela passe évidemment par l'association improbable et pourtant parfaitement logique entre un flic intègre et un voyou au grand cœur. Opposés eux aussi à un mal anonyme, représenté par une masse indistincte d'assaillants interchangeables et mus par un esprit de meute quasi-barbare (la scène où ils mélangent leur sang est à ce titre hautement symbolique) ; le sergent Bishop (Austin Stoker) et le hors-la-loi Napoleon Wilson (Darwin Joston en véritable prototype de l'anti-héros carpenterien) s'allient avec un naturel désarmant, chacun reconnaissant en l'autre un combattant guidé par le même sens de l'honneur et surtout du refus d'abdiquer. C'est donc côte-à-côte qu'ils ressortiront vainqueurs du commissariat assiégé, et cela en dépit des récriminations des renforts policiers arrivés bien trop tard. Le message est évident : si deux fortes personnalités s'allient avec un respect mutuel, l'ordre s'effondre tant il ne repose tout compte fait sur rien.
Il faut cependant notifier que cette alliance est en quelque sorte articulée autour du personnage de Leigh (Laurie Zimmer), secrétaire dont la neutralité favorise le rapprochement entre les deux combattants : elle est en quelque sorte une caution morale, tant la sympathie dont elle gratifie aussi bien l'un que l'autre souligne une valeur commune qui ne peut que s'aimanter.
La Sainte Trinité
La figure féminine comme gage de raison et donc d'espoir parcourra ensuite toute la filmographie de Carpenter, sans qu'il ne tombe jamais dans un féminisme un peu trop ostensible pour être honnête (quoi, qui a dit Tarantino ?). Chez Big John, le sexe importe peu : une femme débute aussi bas qu'un homme, et doit elle aussi prouver sa valeur afin d'être célébrée. Si sa vision demeure indéniablement genrée et s'il peut donc faire preuve d'un peu plus de bienveillance envers elles (après tout, sa filmo ne compte qu'une seule vraie méchante en la personne de Meg Foster dans Invasion Los Angeles), une femme n'aura pour autant droit à aucun traitement de faveur et ne sera jamais présentée de facto comme une héroïne à la badassitude portée en étendard. Rien d'injuste là-dedans, au contraire : cette complexité est garante de richesse, et donc de personnages féminins profondément forts qui peuvent in fine se targuer d'égaler leurs collèges masculins.
La meilleure représentante de cet état de fait est sans nul doute Melanie Ballard, la fliquette de l'espace incarnée par Natasha Henstridge dans Ghosts of Mars.
Un film mésestimé, qui traduit pourtant nombre d'obsessions de son auteur avec une rage peu commune dans sa filmographie. Ainsi, lors d'une longue exposition qui souligne une fois de plus le dégoût de Carpenter pour l'assimilation et l'uniformisation (les scarifications absolument dégueulasses que s'infligent les possédés sont à ce titre on ne peut plus explicites), chaque personnage est planté, défini, assigné à un rôle précis... Que le réalisateur va démolir un à un dans un violent jeu de massacre qui expose les faiblesses de nombre de protagonistes : Jason Statham en dragueur aussi ridicule que viriliste tient à peine la distance (un rôle ambivalent qu'il ne jouerait probablement plus aujourd'hui), pas plus que les flics soi-disant de choc ou les hors-la-loi vantards qui entourent Desolation Williams (Ice Cube).
Desolation Williams, enfermé mais pas pour longtemps
Ne restent donc plus au final que celui-ci, nouvel avatar de l'antihéros selon Carpenter (et cela d'autant plus que Ghosts of Mars recycle le script abandonné d'une ultime aventure de Snake Plissken) ; associé à une Melanie qui renvoie ouvertement au sergent Bishop d'Assaut. Dans l'action, la fliquette de prime abord sans épaisseur aura révélé une humanité touchante, tandis que le hors-la-loi apparemment blasé se sera acharné à faire preuve d'honneur. Par-delà leurs affectations sociales, qui n'ont d'ailleurs plus lieu d'être puisque l'Apocalypse est imminente, deux individus auront sublimé leurs forces respectives pour devenir un couple dont la force surpasse les simples enjeux romantiques usuellement en cours à Hollywood.
"Si je t'aime, ce n'est point par amour d'un être supérieur dont tu serais l'enveloppe consacrée, ce n'est pas que je voie en toi un fantôme et que j'y devine un esprit; c'est par égoïsme que je t'aime ; c'est toi-même, avec ton essence, qui m'es cher, car ton essence n'est rien de supérieur, elle n'est ni plus haute ni plus générale que toi, elle est unique comme toi-même, c'est toi-même."
Et Carpenter de conclure son film sur une image hautement symbolique, qui voit une fliquette aryenne en tenue de cuir avec sigle rouge sur l'épaule marcher aux côtés d'un hors-la-loi incarné par l'ex-leader du groupe de rap NWA. Y a-t-il meilleur moyen de renvoyer les grandes théories sur l'affectation sociale ou même la lutte des classes dans les cordes ? Pour Carpenter comme pour Stirner, la seule lutte qui prévaut est celle de l'individu sur un monde hostile et ceux qui prétendent le régir, et seuls les individus qui osent outrepasser les considérations idéologiques sont à même de former des alliances dignes de ce nom.
"Let's kick some ass !"
En vingt-cinq ans d'exercice, John Carpenter est donc passé d'une figure féminine faisant office de médiatrice à une antihéroïne hissée au rang d'un Snake Plissken. L'évolution fut aussi progressive que maîtrisée, et mérite que l'on s'y penche... D'autant plus que le dernier film de Big John est on ne peut plus féminin.
IN TOUCH WITH YOUR FEMININE SIDE
Il est étonnant de constater que Carpenter se repose essentiellement sur des personnages féminins lorsqu'il réalise de purs films de commandes qu'il qualifie lui-même d'œuvres mineures. Il ne faut cependant pas y voir une volonté de faire passer ces personnages au second plan dans sa carrière, mais plutôt de les mettre en valeur face à des héros sans grande envergure pour lesquels il n'a que peu d'appétence. Ainsi, Alexandra Paul, Karen Allen et Daryl Hannah sont-elles respectivement les vraies figures de proue de Christine, Starman et Les Aventures d'un Homme Invisible.
Ci-dessus : Alexandra Paul, Karen Allen et Daryl Hannah dans les films en question
Qu'il s'agisse de raisonner un ado maladivement obsédé par une bagnole démoniaque qui ne cesse de le dépersonnaliser (Christine), de guider et même d'éduquer un visiteur extraterrestre par trop naïf (Starman) ou de servir de contrepoids à un Chevy Chase franchement embarrassant en homme invisible (et avec lequel Carpenter ne s'est pas du tout entendu) ; ces femmes à priori de second plan se révèlent in fine les seuls phares d'œuvres calibrées et uniformisées. Des commandes qui ne doivent donc leur salut qu'à la mise en scène toujours impeccable de Carpenter, ainsi qu'à sa propension à approfondir à sa manière des produits somme toute superficiels. Guidées par la raison, toujours capables de recul et d'analyse, faillibles et néanmoins conscientes de l'être ; ces trois femmes apportent à ces films d'indéniables qualités humaines.
On notera la savoureuse mise au premier plan d'Hannah sur l'affiche des Aventures d'un Homme Invisible, en comparaison de Chase réduit en vague visage flottant. Dans certains pays, l'acteur a même été carrément effacé de l'image
Cet angle d'attaque, que d'aucuns assimilent parfois abusivement à une candeur mal placée, fut d'ailleurs source d'incompréhension vis-à-vis d'un des fleurons du cinéaste et de la figure féminine qui en est le pilier. Je parle évidemment de Laurie Strode dans Halloween.
Jamie Lee Curtis dans son rôle le plus culte
Les critiques à la ramasse qui taxèrent le film de réactionnaire en 1978 ont encore cours et collent même aux fesses du slasher, cet appendice de l'horreur injustement méprisée et que Carpenter a défini quasiment à lui tout seul.
S'il est vrai que certaines itérations pour le moins bancales n'y sont pas allées de main morte avec la figure virginale de la final-girl, les plus grands héritiers de Carpenter ont bien compris que la chasteté de Laurie ne signifiait aucun propos rétrograde, mais simplement l'incarnation la plus évidente d'un certain sens des responsabilités. Wes Craven réutilisera notoirement le procédé avec Nancy des Griffes de la Nuit tout comme avec Sidney de Scream, deux autres jeunes filles qui révèlent in fine une force qui dépasse le simple assouvissement de désirs sexuels. Procédé maladroit ? Peut-être, mais on arguera dans ce cas que ni Big John ni Craven ne nient pour autant la sexualité de leurs héroïnes : dans le cas de Laurie, celle-ci révèle même ses goûts en matière de mec à sa meilleure amie. Laurie n'est pas un personnage asexué, et son refus de s'envoyer en l'air le soir d'Halloween ne doit jamais être interprété que comme un moyen de planter sa personnalité en peu de temps : en un sens déjà plus mature qu'eux, Laurie est parvenue à surpasser ses tiraillements hormonaux pour viser plus haut. Nul doute que son application scolaire souligne quelque ambition professionnelle qu'un patelin tel qu'Haddonfield ne peut offrir, tandis que son sérieux vis-à-vis des enfants qu'elle garde (là où ses comparses s'en débarrassent au plus vite) traduit une véritable appréciation des besoins d'autrui. Encore une fois, la nuance de l'égoïsme stirnerien passe donc par une figure féminine.
Haddonfield : ses rues mornes, son centre-ville minuscule, son stalker psychopathe aux aguets
La tâche à laquelle Laurie s'est elle-même assignée devrait suivre son petit bonhomme de chemin, mais est évidemment troublée par l'irruption d'une figure maléfique quasi-anonyme, le plus souvent indiscernable de par sa propension à se faufiler dans les ténèbres, et dont le retour à Haddonfield n'est jamais dû qu'à la profonde incompétence d'administrations bancales. Le très dévoué Dr. Loomis (Donald Pleasence) ne cesse en effet de le répéter à qui veut l'entendre : il s'est battu pour que Michael Myers (Nick Castle) ne sorte jamais de sa cellule, et ne s'est heurté qu'à des murs incapables de se hisser à son niveau de réflexion. La symbolique est évidente, et Laurie et son sens des responsabilités deviennent dès lors le meilleur contrepoids du tueur, véritable reflet des failles de la société.
Le médecin face au policer, l'intellect face à l'autorité, l'homme face à la société
Reste enfin le cas de The Ward, à ce jour (et probablement à jamais) dernier film de Carpenter. Un long-métrage tout aussi voir plus mésestimé que Ghosts of Mars alors qu'il fait lui aussi part de toutes les obsessions inhérentes à l'œuvre du maître, sous le prisme d'une évolution subtile mais certaine.
Ainsi Big John achève-t-il sur un huis clos féminin une carrière débutée par un huis-clos masculin (Dark Star, film d'études rallongé en métrage exploitable en salles), et cela après avoir lentement mais sûrement mûri sa représentation du féminin. Mais alors qu'on aurait pu croire que la Melanie Ballard de Ghosts of Mars marquait cet aboutissement thématique, voici que The Ward propose un récapitulatif tout autant qu'une inversion de certaines figures récurrentes de son œuvre. Tandis que sortir du vaisseau de Dark Star signifiait une mort imminente, sortir de l'asile de The Ward marque un retour à la liberté. Alors que Michael Myers s'échappait d'un hôpital pour abattre son courroux, les héroïnes sont ici enfermées dans une enceinte (in)hospitalière qui est à elle seule le courroux. Alors que l'armada de fantômes de Fog appliquait une vengeance somme toute ciblée, l'unique fantôme de The Ward s'attaque à tout ce qui bouge sans le moindre discernement. Et enfin, alors que le John Trent de L'Antre de la Folie cherchait à tous prix à échapper à la maladie mentale, les protagonistes de The Ward y sont plongées dès le départ. Ou plutôt la protagoniste, puisque chaque personnage n'est en vérité que l'incarnation de chacune des personnalités de la pauvre Alice (Mika Boorem).
Des personnalités qui, à y regarder de plus près, ne sont jamais que des représentations presque caricaturales de figures féminines qui traversent les arts narratifs depuis la nuit des temps : la séductrice (Danielle Panabaker), la fillette (Laura-Leigh), la sainte (Lyndsy Fonseca), la sorcière (Mamie Gummer)... La dernière venue, Kristen (Amber Heard), pourrait elle aussi se rattacher à ce genre d'archétype : elle est la rebelle, la guerrière, celle qui ose affronter la hiérarchie tout autant que le fantôme meurtrier.
L'image lourde de sens qui ouvre le film : des policiers qui se jettent sur une Kristen agenouillée
Et c'est d'ailleurs sur ce ressort que le film dévoile toute sa richesse thématique, puisque Kristen est aussi salvatrice que nocive : elle est certes la force sur laquelle se repose Alice pour vaincre ses démons et contester un personnel médical plutôt sadique ; mais plus elle gagne en force et plus elle annihile à son tour Alice, jusqu'à devenir lors du dernier plan le nouveau fantôme que cette dernière doit éradiquer.
Une mise en garde de Carpenter sur le culte du Moi ? Peut-être, ou tout du moins une nuanciation, qui passe évidemment par l'emploi d'une de ces figures féminines tant révérées par le cinéaste.
V'là la gueule du Moi
Mais l'on pourrait aussi y voir l'auto-analyse d'un homme d'expérience, qui passa sa vie à se battre contre toute forme d'autorité au risque de devenir à son tour un fantôme oublié, relégué dans les ténèbres par une société invincible... Pour un temps, du moins.
Presque étonné qu'on le prenne enfin au sérieux
Le temps reste et restera probablement toujours la seule échelle valable pour mesurer l'influence d'un penseur ou d'un artiste ; et tout comme Stirner a survécu à la censure et à différents régimes pour revenir hanter le débat philosophique et même politique, John Carpenter atteint enfin, au crépuscule de sa vie, une reconnaissance aussi tardive que méritée : récipiendaire d'un Carrosse d'Or à Cannes, sujet de nombreuses rétrospectives de par le monde, son influence est de plus revendiquée par certains des cinéastes les plus importants qui soient.
Dès lors, difficile de donner tort à son acharnement à s'affirmer et surtout à rester lui-même, qu'il signifiait sans détour aux Cahiers du Cinéma en 2003 lors d'une interview-fleuve : "Depuis que je suis tout petit, on fait pression sur moi pour que je devienne quelqu’un que je ne suis pas. Est-ce que je ressemble à un type qui a envie de rentrer dans le moule ? Fuck you !, ça a toujours été ma réponse."
Rien à ajouter.